Présenté à l’Université Senghor, un mémoire du togolais Frédérick Yao Mawupenkor TSATSU analyse les opportunités et les défis du nouveau régime parlementaire au Togo, en s’appuyant sur des exemples comparés et des recommandations concrètes pour renforcer une démocratie substantive au Togo. Un évènement qui intervient quelques jours après l’entrée en vigueur d’une Ve République qui ne fait pas l’unanimité. Compte rendu.
Abidjan, 19 mai 2025 – Le Togo vit une période charnière de son histoire politique. Après plus de six décennies de centralisation du pouvoir, marquées par des réformes souvent inachevées, le pays a entamé en avril 2024 une réforme constitutionnelle majeure : le passage à un régime parlementaire. Cette transition, inédite dans l’histoire politique du pays, suscite de nombreuses attentes mais également des interrogations profondes. Mais alors que cette Ve République ne fait pas l’unanimité, chose normale, au sein de la classe politique, le Togo fait déjà cas d’école dans des circuits universitaires et cette soutenance consacrée à l’événement aura posé des questions et tenté d’apporter ses réponses. Elle est l’œuvre de Frédérick Yao Mawupenkor TSATSU. Le jeune togolais et diplômé de l’Université Senghor d’Alexandrie, a présenté à Abidjan, ce 19 mai 2025 un mémoire intitulé « Opportunités et défis du nouveau régime parlementaire pour la consolidation de la démocratie substantive au Togo ». Ce travail a été soutenu dans le cadre du Diplôme d’Université en “Démocratie, État de droit et Engagement politique et citoyen dans l’espace francophone”, dispensé par le Département Management de cette université francophone de référence.
La réforme de 2024, un tournant à concrétiser
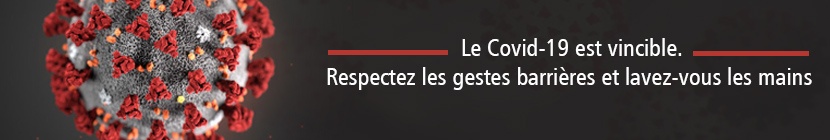
L’auteur part d’un constat : depuis l’indépendance en 1960, la gouvernance togolaise est restée prisonnière d’un schéma présidentialiste hypercentralisé, malgré l’ouverture démocratique amorcée en 1992 avec l’instauration du multipartisme. Cette gouvernance verticale a contribué à cristalliser les tensions sociales, politiques et institutionnelles, tout en limitant l’émergence d’une démocratie substantive. Et pour preuves, les divergences nombreuses dans l’approche de la gouvernance politique et surtout, parfois, des confrontations qui auraient pu être évitées. Pour le récipiendaire, l’adoption du régime parlementaire en 2024, « représente une aubaine historique pour réinventer la manière de faire de la politique au Togo« . Ce qu’il s’est évertué à démontrer en redéfinissantles équilibres institutionnels de ce système qui « pourrait favoriser une meilleure séparation des pouvoirs, responsabiliser les partis politiques, encourager la transparence des décisions publiques et rapprocher les citoyens des processus de gouvernance« . Prudent et objectif, il fait une comparaison de diverses républiques en soulignant les forces et les faiblesses de chaque époque. Sa conclusion est sans appel tout de même, car pour lui, l’ambition de rapprocher les citoyens des processus de gouvernance se heurte à une double réalité « d’un côté, une faible culture parlementaire nourrie par des décennies de présidentialisme fort ; de l’autre, un déficit de confiance et de consensus entre les forces politiques » tranche cet acteur très actif de la société civile togolaise.
Une démarche comparative instructive
Pour éclairer les enjeux dans le contexte du Togo, Frédérick TSATSU s’appuie sur une analyse comparative rigoureuse des modèles du Royaume-Uni et de l’Île Maurice, deux démocraties parlementaires solides où les institutions ont su s’adapter aux contextes locaux. Il en tire des enseignements pertinents sur la mise en œuvre des votes de défiance, le rôle des commissions parlementaires, le contrôle de l’exécutif et la participation du citoyen à la délibération publique.
L’auteur souligne que ces modèles ne sont pas à copier, mais à adapter intelligemment au contexte togolais, en tenant compte des spécificités culturelles, historiques et institutionnelles du pays. Une appréhension très fort applaudie par l’auditoire d’un mémoire académique qui tombe à pic comme un appel aux politiques à se reposer les bonnes questions. Pour le récipiendaire, le rejet systématique pour l’opposition serait un rendez-vous manqué et l’obstination ostentatoire pour la majorité serait réductrice de l’enjeu. Un enjeu qui est la stabilisation d’un pays qui a connu suffisamment de turbulence. Appel à peine voilé à chaque camp à rester ouvert aux concertations.
Des recommandations fortes pour un parlementarisme réussi
Il n’a pas voulu que poser des questions, il se livre à quelques mémorables recommandations tirées de sa profonde connaissance de son pays. Le mémoire propose ainsi un corpus de recommandations stratégiques, entre autres : renforcer les capacités institutionnelles des élus, des commissions parlementaires et des partis politiques par des formations et des ressources adaptées, repenser le système électoral pour garantir une meilleure représentativité ;instaurer des mécanismes de transparence et de redevabilité dans la gestion des affaires publiques ; promouvoir la participation citoyenne, en associant la société civile aux débats parlementaires et en ouvrant les institutions aux attentes du peuple ; favoriser un climat de consensus national, en dépassant les clivages politiques pour construire un socle commun autour de l’intérêt général.
Une contribution engagée au service du Togo
Ce travail universitaire dépasse le cadre académique. Il constitue un véritable outil patriotique de plaidoyer, une contribution citoyenne destinée à nourrir le débat démocratique et à accompagner les réformes en cours. Frédérick TSATSU y affirme ainsi sa volonté de continuer sa démarche prospective avec les institutions publiques, les chercheurs, les parlementaires, les acteurs de la société civile, les jeunesses pour faire du régime parlementaire un levier de transformation réelle. « L’avenir démocratique du Togo ne se joue pas uniquement dans les textes, mais dans la culture politique que nous construisons. Le régime parlementaire peut être un tremplin, à condition qu’il soit sincèrement porté, encadré et approprié par tous les acteurs », conclut-il. En ces temps de reconfiguration institutionnelle, ce mémoire ouvre une voie de réflexion essentielle, à la fois critique et constructive, pour une gouvernance plus inclusive, responsable et respectueuse des aspirations du peuple togolais.
Quoiqu’on ait pensé de cette démarche universitaire, il est hautement politique pour être tombé au bon moment et devrait, à défaut d’avoir la périlleuse ambition de régler toutes les questions de gouvernance, ouvrir le débat non partisan d’un défi, tenter autre chose que ce qui a toujours été essayé.
Afrika Stratégies France.




